Comment ce que nous mangeons exerce t-il une influence sur notre santé mentale ? C’est ce que la psychiatrie nutritionnelle essaye de comprendre. Le point sur les découvertes dans ce domaine et les perspectives de recherche.
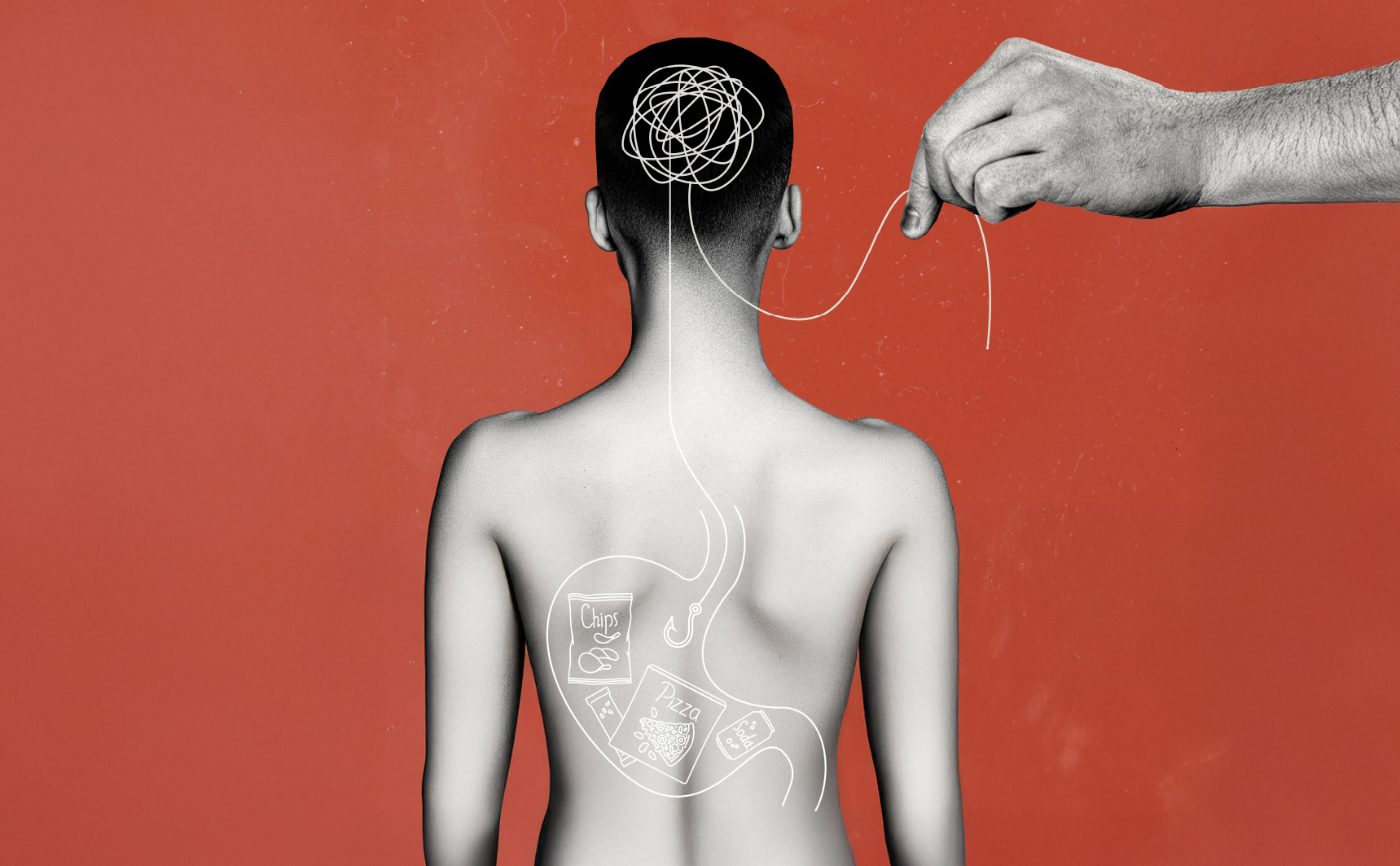
Comment nourrir son cerveau ? Un psychiatre explique l’impact des nutriments sur l’anxiété et l’humeur
N'hésitez pas à nous contacter !
Lorem ipsum Contactez-nous

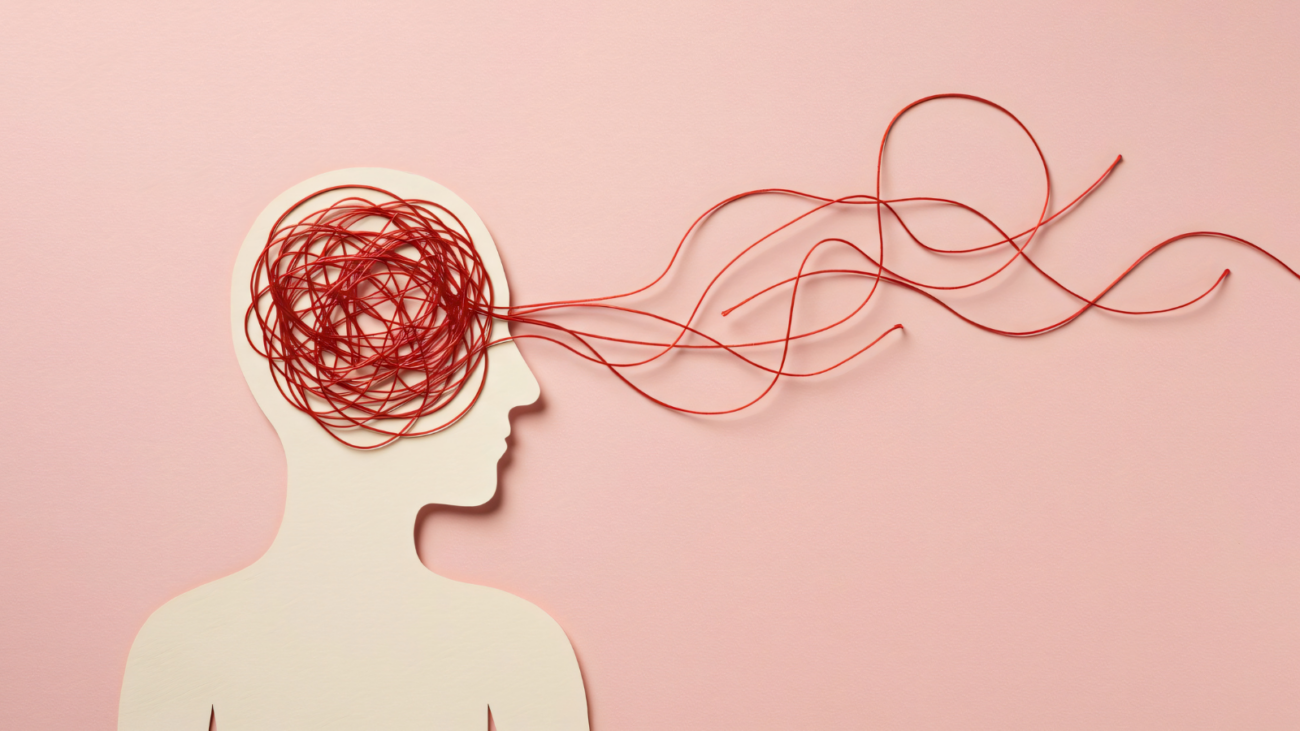


Bien manger est la clé pour être en bonne santé physique, mais aussi pour être bien dans notre tête. La recherche actuelle dans le domaine de la psychiatrie nutritionnelle le prouve. « Elle étudie comment la qualité de l’alimentation, les nutriments et le microbiote intestinal influencent les circuits cérébraux, l’inflammation, l’énergie neuronale et, finalement, les symptômes psychiatriques », explique Guillaume Fond, psychiatre et docteur en biologie cellulaire et moléculaire, auteur de Bien nourrir son cerveau et de Bien manger pour ne plus déprimer (chez Odile Jacob). Avoir de bons apports nutritionnels, variés et équilibrés, est particulièrement important. « Mieux manger améliore l’humeur, tandis qu’une part élevée de produits ultratransformés s’associe à plus de dépressions », constate le spécialiste.
Dépression, trouble bipolaire, autisme…
Justement, « une méta-analyse récente a confirmé l’efficacité de l’alimentation méditerranéenne dans la lutte contre la dépression, avec toutefois une hétérogénéité importante, signe qu’il faut personnaliser les approches, et commencer par réduire la consommation de produits ultratransformés dans tous les cas », ajoute-t-il. Le régime méditerranéen, riche en fibres et en oméga 3, privilégie les fruits et légumes frais, les légumineuses, les céréales complètes mais aussi le poisson et la viande en petite quantité.
Le régime cétogène qui, quant à lui, repose sur une faible quantité de glucides compensée par un apport plus important en lipides et en protéines, intéresse également. « Il est en cours d’étude avec des résultats prometteurs notamment dans le trouble bipolaire », confirme le docteur Fond. Son effet sur l’autisme est actuellement évalué, tout comme ceux des régimes sans gluten et sans caséine (la protéine du lait).
De premiers effets sur la prise en charge de la psychologie nutritionnelle
Les découvertes de la psychiatrie nutritionnelle font petit à petit évoluer la prise en charge des troubles de l’humeur « sans se substituer aux thérapies validées », pointe le psychiatre. « Les recommandations de la Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice (RANZCP) intègrent ainsi l’alimentation, l’activité physique et le sommeil, illustre-t-il. Elles se traduisent par un dépistage diététique, des conseils structurés autour du régime de type méditerranéen, une collaboration avec diététiciens et un suivi d’objectifs métaboliques et psychiatriques. » De plus, des lignes directrices internationales, dédiées au lifestyle-based mental health care (les soins de santé mentale axée sur le mode de vie), existent pour les adultes atteints d’un trouble dépressif majeur, toujours en complément des thérapies.
la psychologie nutritionelle : Les pistes de recherche actuelles
Pour aller plus loin dans la compréhension des différents mécanismes, la recherche se poursuit. Pour Guillaume Fond, l’une des priorités est d’évaluer « l’efficacité de combinaisons ciblées de nutriments ayant montré une influence sur la santé mentale ». En parallèle, « des essais sur les psychobiotiques – des probiotiques qui régulent le fonctionnement du système nerveux central –, plus longs et standardisés, doivent être menés ». Enfin, des études s’attellent à apprécier les effets des régimes anti-inflammatoires accompagnés d’une réduction des produits ultratransformés et des protocoles de chrononutrition (fondés sur l’horloge biologique) sur le sommeil et l’humeur.
Autant de pistes qui permettront probablement d’améliorer la prise en charge des troubles de la santé mentale, voire de prévenir leur survenue.
Léa Vandeputte